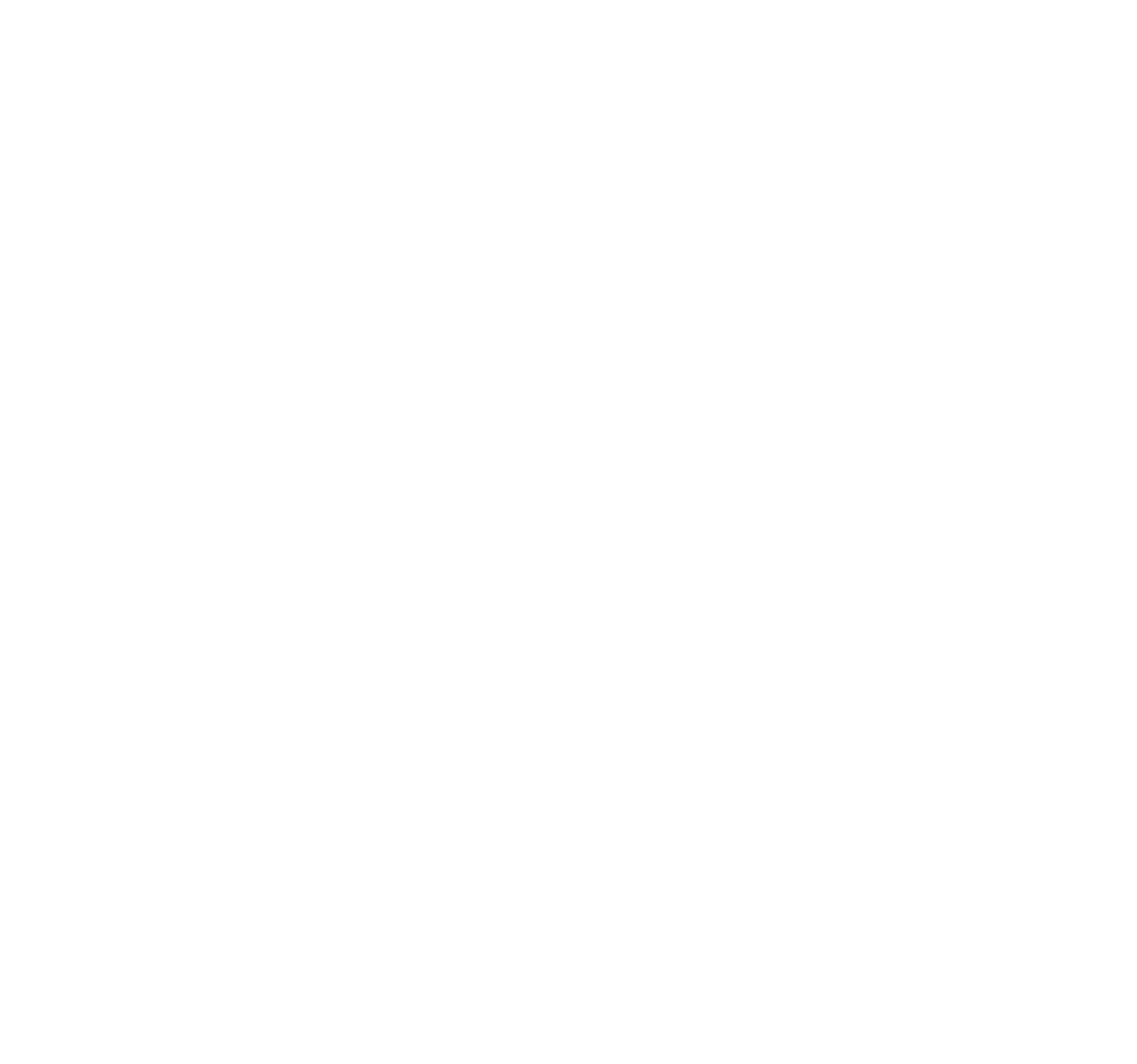Tarification des ESMS : de l’acte technique au levier stratégique
Bien utilisée, la tarification des ESMS est un outil stratégique qui soutient les orientations de l’action sociale et oriente les choix des établissements. Négligée, elle peut notamment générer tensions, difficultés de gestion et obstacles à la transformation de l’offre. Cet article explore ces enjeux et propose deux pistes concrètes pour mettre le pilotage financier au service de la stratégie publique.
La tarification peut dépasser le calcul budgétaire pour devenir un levier de transformation
La tarification n’est pas un simple exercice comptable : elle est un outil stratégique de pilotage, de contractualisation et de régulation de l’offre sociale. Bien menée, elle éclaire la situation des établissements, mais elle permet surtout de rendre possibles les orientations de l’action publique. Le levier financier peut être mobilisé pour accompagner des évolutions jugées prioritaires par le conseil départemental – par exemple, favoriser la transformation d’une offre d’hébergement collectif vers des dispositifs plus inclusifs en milieu ordinaire – ou, à l’inverse, freiner les pratiques qui ne s’inscrivent pas dans la stratégie territoriale.
Ainsi, au-delà des équilibres budgétaires, la tarification peut devenir un instrument d’incitation positive ou négative au service des politiques sociales : elle ne se limite pas à financer des charges, elle oriente des choix collectifs.
Contractualisation et allocation à la ressource : promesse d’efficacité ou impasse ?
Les évolutions récentes de la tarification – en particulier la tarification à la ressource et le renforcement de la contractualisation – modifient profondément le rôle des autorités de tarification et celui des organismes gestionnaires.
Dans leur mise en œuvre la plus positive, elles favorisent un positionnement responsable de chaque partie prenante, en instaurant un mécanisme incitatif à une bonne gestion des deniers publics tout en concentrant les dialogues de gestion sur les véritables enjeux de politiques publiques au bénéfice des usagers.
Au contraire, dans un cas extrême, ces mêmes évolutions peuvent renforcer les difficultés de gestion et multiplier les conflits devant le tribunal, par voie de presse ou lors des dialogues de gestion. L’OG peut pointer l’insuffisance des financements publics tandis que l’autorité de tarification constate l’incompatibilité d’un taux d’évolution ou d’une équation tarifaire avec les demandes du gestionnaire. Le résultat : déficits creusés, incapacité à investir, tensions et conflits… Aussi, comme le rappelle l’affaire ORPEA, des gestionnaires peu scrupuleux peuvent exploiter le système au détriment des usagers.
Deux pistes concrètes pour mettre le pilotage financier au service de la politique publique:
Définir et partager la stratégie de l’institution : il ne suffit pas de fixer des objectifs généraux. La stratégie doit expliciter clairement les modalités d’atteinte de ces objectifs et être suffisamment transparente pour que les gestionnaires puissent comprendre les priorités et ajuster leurs décisions en conséquence.
Une pratique efficace mais pourtant peu courante consiste à intégrer explicitement la dimension financière dans les documents stratégiques de programmation et leurs diagnostics, afin que le pilotage budgétaire serve directement les orientations de l’action sociale.
Cette approche permet de relier les moyens alloués aux évolutions souhaitées de l’offre. Le développement de dispositifs inclusifs, l’amélioration de la qualité des services ou l’optimisation des ressources pluriannuelles en sont de bons exemples. En investissant du temps dans cette formalisation, l’autorité de tarification transforme le contrôle financier en véritable levier de gouvernance et de pilotage stratégique, garantissant cohérence, transparence et impact sur le long terme.
· Assumer le rôle de contrôleur de gestion de l’autorité de tarification : analyser les comptes de façon proactive (y compris en phase budgétaire) pour détecter les problématiques structurelles, contrôler les dépenses et rejeter les charges anormales (CA/ERRD), analyser la situation financière des établissements pour optimiser l’affectation ou la reprise des résultats, prendre la mesure des enjeux des tarifications pluriannuelles (frais de siège, PPI).
Finissons-en avec l'idée reçue selon laquelle « nous tarifons à la ressource, nous ne contrôlons plus les dépenses » : des alertes récentes (ex. ORPEA) démontrent que sans vigilance, les ressources peuvent être utilisées de manière inappropriée. Cette approche ne relève pas seulement de la maîtrise budgétaire : elle constitue aussi un outil de protection des usagers et d’accompagnement des établissements en difficulté.
En pratique, chaque décision financière contribue ainsi à renforcer la qualité des services et à répondre aux besoins des usagers, conciliant rigueur budgétaire et ambition politique. À la croisée des chiffres et des choix collectifs, la tarification apparaît finalement comme un instrument de pilotage au service de l’action sociale, au bénéfice des établissements et des usagers.
Qu’elles soient réalisées en interne ou déléguées, les prestations techniques de tarification permettent aux directions de se recentrer sur l’accompagnement des évolutions de l’offre sociale : répondre aux besoins émergents, améliorer la qualité et favoriser l’inclusion.
Ayant déjà travaillé avec plusieurs DREETS et Conseils départementaux, et intervenant en sous-traitance d'un cabinet d'expertise comptable dans ce domaine, BMSE est une entreprise agile qui propose un accompagnement sur mesure afin de répondre aux besoins stratégiques des autorités de tarification.
Qu'il s'agisse d'accompagnement à l'élaboration de CPOM, de sous-traitance de la tarification des établissements, ou encore d'étude des frais de siège et/ou de PPI, le positionnement de BMSE est d'être un collaborateur au service de la stratégie de la collectivité.
Contact: Pauline BARBAUX MORALES - bmse.contact@gmail.com
Publié le 09/09/2025